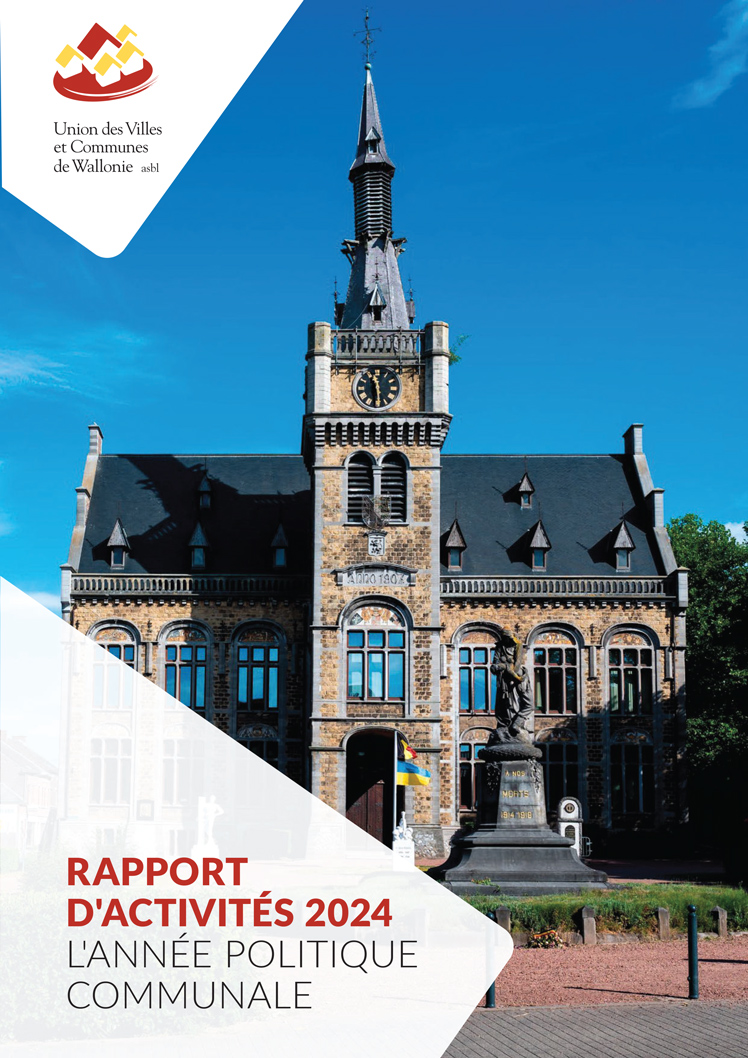Focus sur quelques grands dossiers
Le Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces a apporté son conseil et son expertise dans toute une série de dossiers qui se sont développés durant l’actuelle législature. Nous en citerons quelques-uns qui ont mobilisé les énergies et suscité bien des débats.
1. Formation professionnelle continue
La formation en cours de carrière des membres du personnel (MDP) de l’enseignement était auparavant régie par deux décrets, l’un visant l’enseignement fondamental et l’autre visant l’enseignement secondaire, l’enseignement spécialisé et les CPMS.
Il est apparu pertinent de l’organiser via un décret unique dans un souci de cohérence du système éducatif, dans la perspective du développement d’un tronc commun et d’une école inclusive.
Ce nouveau décret portant sur le livre 6 du code de l’enseignement et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l’équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l’équipe pluridisciplinaire des centres PMS a été voté par le Parlement de la Communauté française le 17 juin 2021. Le nouveau dispositif de formation professionnelle qu’il consacre est entré en vigueur à la rentrée scolaire 2022.
Il a été élaboré principalement sur la base de l’avis n°3 du Groupe central du Pacte pour un Enseignement d’excellence, fortement inspiré des propositions émises conjointement par les réseaux subventionnés dans le cadre des travaux liés à la réforme de la formation en cours de carrière. Il puise également ses fondements dans les réalités vécues dans la mise en œuvre des décrets de 2002 et dans la « Note bilan des 10 ans de la formation », adoptée par la Commission de Pilotage en février 2013.
Ce décret vise prioritairement à renforcer, à améliorer et à dynamiser la formation professionnelle continue (FPC) en s’inscrivant de manière continue dans le cadre du développement professionnel lié à l’exercice du métier.
La FPC est un moyen pour améliorer la qualité de l’enseignement notamment en poursuivant les objectifs généraux suivants :
- Contribuer à l’amélioration de la qualité du système éducatif (objectifs d’amélioration) ;
- Développer des compétences collectives et personnalisées pour rencontrer les objectifs spécifiques de l’école ;
- Entretenir, perfectionner et ajuster des connaissances/compétences.
La FPC repose sur un dispositif de pilotage de la formation permettant d’identifier les besoins de formation prioritaires tout en articulant les besoins du terrain et les besoins liés aux orientations du système éducatif.
Dans un souci de complémentarité et de cohérence, la FPC s’articule autour de deux niveaux de formation :
- Le niveau inter-réseaux est organisé par l’Institut de la Formation professionnelle continue (IFPC). Ces formations répondent aux besoins qui ressortent soit des objectifs d’amélioration du Système éducatif, soit des objectifs particuliers, soit de l’analyse des plans de formations de l’ensemble des écoles ou des CPMS.
- Le niveau réseau est organisé par chaque Fédération des Pouvoirs Organisateurs. Ces formations répondent aux besoins qui ressortent soit du projet éducatif et pédagogique de chaque pouvoir organisateur ou de chaque FPO, soit de l’analyse des plans de formations des écoles.
Le Conseil de l’Enseignement des Communes et des provinces a pour mission d’organiser les formations du niveau réseau pour les PO affiliés. (Un pouvoir organisateur qui n'est pas affilié à une Fédération de pouvoirs organisateurs conclut une convention portant sur la formation professionnelle continue avec Wallonie-Bruxelles Enseignement ou avec une Fédération de pouvoirs organisateurs au plus tard quatre mois après la création de l'école ou du Centre PMS. A défaut d'avoir pu trouver un accord avec le partenaire de son choix, le pouvoir organisateur concerné conclut une convention avec Wallonie-Bruxelles Enseignement, chaque partie pouvant solliciter l'arbitrage du gouvernement en cas de désaccord sur certains éléments de la convention).
La FPC s’organise selon deux types de formation :
- Les formations qui répondent à des besoins collectifs s’administrent dans le cadre de la formation obligatoire, soit 6 demi-jours par année scolaire qui sont capitalisables sur 6 années. Les cours sont suspendus. Elles se déroulent avec l’ensemble ou une partie de l’équipe ;
- Les formations qui répondent à des besoins personnalisés sont facultatives et volontaires. Le bénéficiaire dispose de 10 demi-jours pour se former durant son horaire de travail ; il bénéficie de 5 demi-jours supplémentaires durant ses 5 premières années d’enseignement.
Dans la logique du nouveau modèle de gouvernance, le plan de formation fait partie intégrante du plan de pilotage : co-construit avec l’ensemble de l’équipe éducative pour une durée de 6 ans, il vise à identifier les compétences indispensables pour répondre aux objectifs spécifiques de l’école/CPMS, définir les besoins de développement professionnel, intégrer la planification des besoins et aborder la manière dont le transfert des acquis des formations est envisagé. Le plan de formation fait l’objet d’un avis des organes locaux de concertation sociale.
Afin de rendre le MDP acteur de son développement professionnel, le bénéficiaire de formation développe, dans le portfolio, son projet personnel de formation en regard de la fonction exercée et sa contribution à la mise en œuvre du plan de formation de l’équipe. Les attestations de fréquentation des formations y sont obligatoirement consignées. Toutes les traces utiles traçant le cheminement de son développement professionnel et/ou les traces expérientielles de compétences développées et acquises sont intégrées au portfolio de manière facultative. Le portfolio reste un outil formatif.
La FPC élargit le champ des possibles :
- Elle propose de nouvelles modalités de formation comme les communautés d’apprentissage professionnelles (CAP), le E-learning, et l’immersion dans d’autres écoles, dans d’autres niveaux, dans d’autres régions en vue de partager et d’analyser les pratiques ;
- Elle s’ouvre à un public plus large en offrant, par exemple, la possibilité à des bénéficiaires externes à l’équipe éducative de se former conjointement sur des thématiques pour lesquelles cela s’avérerait pertinent ;
- Elle permet aux enseignants entre deux intérims d’accéder aux formations.
2. Parcours d’éducation culturel et artistique (PECA)
L’avis n?3 du Groupe central et, depuis le 13 octobre 2022, le décret relatif au PECA prévoient l'intégration de la culture et des arts au parcours scolaire comme un objectif stratégique d'amélioration de la qualité du système scolaire au sein de l'Axe stratégique 1 intitulé "Enseigner les savoirs et compétences de la société du 21e siècle et favoriser le plaisir d’apprendre, grâce à un enseignement maternel renforcé, à un tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire et à un cadre d’apprentissage révisé et reprécisé".
Pour concrétiser cette ambition, le Groupe central a présenté des orientations interdépendantes qui s'imbriquent les unes dans les autres :
- Assurer à tous les élèves un égal accès à l'art et à la culture ;
- La mise en œuvre, au sein des écoles et tout au long du cursus scolaire, d'un Parcours d'Éducation culturelle et artistique (PECA) qui doit s’étendre du maternel à la fin du secondaire et constituer un trajet construit et articulé qui assure la continuité des apprentissages ;
- La co-construction conjointe du PECA par l'ensemble des acteurs impliqués, ce qui induit des moments de rencontres et des pratiques culturelles en intra et extramuros ;
- Le PECA, transversal à l’ensemble des savoirs et compétences composant le cursus scolaire, doit s’inscrire souplement, mais de manière pérenne, dans l’organisation du temps scolaire. (2 h dans le primaire et 4h en maternelle par semaine)
- Le PECA doit "être construit par les directions et équipes éducatives de chaque école en partenariat avec le monde artistique et culturel et être intégré au plan de pilotage de l’école. Sa conception et sa mise en œuvre s’inscrivent pleinement dans les nouveaux principes de gouvernance du système scolaire".
Pour s'assurer de l'opérationnalisation de ces diverses orientations, au sein de chaque école, le décret du 25 mars 2021 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement finance des postes de référent culturel au sein de chacun des réseaux.
Le texte veille à harmoniser le statut des référents culturels et artistiques aux autres conseillers au soutien et à l'accompagnement en les dotant des mêmes droits et devoirs. Il reconnait à ce référent un rôle crucial d’accompagnement à la conception et à la mise en œuvre du PECA au sein des écoles en précisant les missions des référents culturels ainsi que les modalités d'engagement et de formation de ces derniers.
Dans ce contexte, il est octroyé, aux fédérations de Pouvoirs Organisateurs et à WBE, des ressources équivalentes à 40 emplois à temps plein à la huitième année d’implémentation du PECA. Dès lors, chaque FPO et WBE ont reçu une enveloppe budgétaire supplémentaire, qu’elle a consacrée à l’engagement de référents culturels et artistiques depuis le 1er septembre 2021.
Le CECP a donc reçu une dotation pour 8 postes référents culturels.
Dans le cadre de la philosophie développée au sein du CECP, les référents culturels :
- soutiennent les enseignants dans l’appropriation pédagogique de l’éducation culturelle et artistique
- favorisent la mise en lien des écoles avec le monde culturel, et inversement
- accompagnent les équipes dans la collaboration nécessaire au PECA en interne (travail d’équipe pour concevoir le parcours à l’échelle de toute l’école)
- représentent les écoles, font remonter les besoins et donnent leur expertise aux instances de pilotage du PECA
- collaborent étroitement avec les Groupement d’opérateurs culturels et leur coordinateur pour mener des actions conjointes au sein des établissements scolaires
- encadrent les délégués PECA au sein des établissements scolaires lorsque ceux-ci ont été désignés par le chef d’établissement de manière bénévole ou au sein des heures de missions collectives
Un décret relatif au parcours d’éducation culturelle et artistique est entré en application le 13 octobre 2022.
Le Parcours d’éducation culturelle et artistique (PECA) est l’un des objectifs stratégiques de l’axe 1 du Pacte pour un enseignement d’excellence. Ce texte permet à tous les élèves, de la maternelle à la fin du secondaire, d’être concernés, chaque année, par le PECA. Il s’étendra donc au-delà du tronc commun qui n’inclut que l’enseignement fondamental et l’enseignement secondaire inférieur.
Rappelons que le Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire prévoit que les pouvoirs organisateurs et les équipes éducatives doivent notamment veiller à ce que l’école stimule la créativité, singulièrement en offrant à tous les élèves un parcours d'éducation culturel et artistique, ainsi que l'engagement et l'esprit d'entreprendre en tant qu'aptitudes à associer les actes aux idées (article 1.4.1-2 du Code). De la même manière, la constitution prévoit des droits culturels (voir aussi article 27 de la déclaration des Droits de l’homme) article 23, 5.
Dans ce cadre, le texte rappelle que les objectifs du PECA sont de permettre à chaque élève d’accéder à la vie culturelle, de rencontrer des œuvres, des artistes et des pratiques culturelles, de fréquenter des lieux culturels, d’acquérir des savoirs, des connaissances et des compétences en matière culturelle et artistique, notamment au travers du cours dédié à l’éducation culturelle et artistique (ECA) et ce dans une perspective de développement de l’esprit critique et de l’expression personnelle, d’expérimenter des pratiques culturelles et artistiques et de prendre une part active dans la vie culturelle, d’accéder et de participer à la diversité des vies culturelles et artistiques et de se familiariser avec des expressions culturelles provenant de différents horizons, exprimant différentes représentations du monde c’est-à-dire de faire valoir justement ces droits culturels.
Il est prévu la possibilité pour chaque école de désigner, notamment dans le cadre des périodes de missions collectives, un délégué-PECA, interlocuteur privilégié des référents culturels au sein des établissements, qui est chargé d’être à l’écoute des besoins et des aspirations de son école par rapport au PECA, de l’informer des projets mis en place au niveau de la plateforme territoriale auquel il peut notamment être invité à participer, de répercuter les informations reçues au niveau de cette plateforme territoriale et de formuler des propositions à la direction en matière de PECA. Cette désignation n’est pas obligatoire, mais des heures de missions collectives peuvent être octroyées par la direction.
Par ailleurs, un Groupement coordonné d’opérateurs culturels appelé référence scolaire est désigné par zone pour coordonner, développer, compléter l’offre culturelle et artistique à destination des écoles et organiser la mise en relation entre les écoles et les artistes, opérateurs culturels et l’ESAHR.
La référence scolaire, collaborateur privilégié des référents culturels dans le monde culturel, animera également la plateforme territoriale qui regroupera 1 délégués-PECA invité par réseau, un représentant du service du pilotage PECA, des référents culturels et un représentant de l’ESAHR. Les délégués PECA sont des membres du personnel enseignant, désignés sur une base volontaire qui ont pour mission :
1° de répercuter dans son école les informations reçues au niveau de la plateforme territoriale PECA ;
2° être à l'écoute des besoins et des aspirations de son école par rapport au parcours d'éducation culturelle et artistique, et porter sa représentation au niveau de la plateforme territoriale PECA ;
3° de participer à la mise en place de projets au niveau de la plateforme territoriale PECA ;
4° le cas échéant, de formuler des propositions au directeur en vue de l'intégration ou du renforcement du parcours d'éducation culturelle et artistique dans le contrat d'objectifs de l'école. ».
Cette plateforme a vocation à être un lieu de rencontres et d’échanges des acteurs du PECA dans le but notamment d’assurer la concertation relativement aux besoins des écoles et aux offres culturelles et artistiques disponibles.
3. Pilotage des écoles
La totalité des écoles communales se sont dotées d’un plan de pilotage qui suite à la contractualisation entre le PO et le Gouvernement s’est vu intitulé contrat d’objectifs.
Le déploiement de ce nouveau modèle de gouvernance des écoles a fonctionné en trois vagues.
Toutes les écoles mettent actuellement en œuvre leur Contrat d’Objectifs qui, au terme des trois premières années, est soumis à une évaluation intermédiaire. Celle-ci consiste en une analyse de l’impact des premières actions activées sous forme d’un dialogue avec le Pouvoir régulateur et plus spécifiquement le Délégué aux contrats d’objectifs qui représente celui-ci. Actuellement, les deux tiers des écoles en sont à cette étape de vie de leur contrat d’objectifs. Dans la majorité des cas, cette étape du cycle de vie du Contrat d’objectifs se déroule favorablement, un dialogue constructif est établi avec le Gouvernement par le biais des DCO (Délégués au Contrat d’Objectifs) avec le soutien des conseillers du CECP.
Quelques écoles sont identifiées chaque année scolaire par le Gouvernement comme étant « En Dispositif d’Ajustement (EDA) » car, au regard de quatre indicateurs relatifs aux résultats et au parcours des élèves, au climat de l’école et à l’équipe pédagogique, elles sont les plus éloignées de la moyenne des établissements de même profil et appartenant à un même groupe de classes socioéconomiques. Ces dernières bénéficient d’un suivi plus particulier ainsi que de moyens spécifiquement dédiés à l’amélioration de leurs résultats.
4. Evaluation des enseignants
En parallèle au processus d’évaluation mis en place dans les secteurs privé et public, l’Avis n°3 du Pacte pour un Enseignement d’excellence insiste sur la nécessité de valoriser et de responsabiliser les membres du personnel de l’enseignement obligatoire et non obligatoire dans le cadre d’une dynamique collective d’organisation apprenante et d’une évolution substantielle de leur métier liée aux enjeux actuels de l’école.
Dans ce cadre, l’évaluation de ces membres du personnel doit avant tout avoir pour finalité de leur permettre d’évoluer positivement dans leur carrière, de pointer les besoins de formation et les formes de soutien nécessaires au développement et/ou au renforcement des compétences professionnelles, de valoriser le travail effectué, de responsabiliser et de renforcer l’implication dans l’action collective. Néanmoins, leur évaluation doit aussi permettre aux pouvoirs organisateurs de réagir de manière objective à d’éventuels manquements répétés, voire à une mauvaise volonté manifeste mettant en péril, notamment, la mise en œuvre du contrat d’objectifs.
Le dispositif d’évaluation du personnel enseignant s’organise en deux volets. Le volet de développement des compétences professionnelles par le biais d’entretiens de fonctionnement réguliers (idéalement 1 fois par an et, à défaut, une fois tous les trois ans) menés par la direction d’école (ou, en cas de délégation, par une direction adjointe ou un enseignant expérimenté dans l’enseignement secondaire uniquement[1]), tous formés à cet effet, et la contractualisation d’un plan de développement des compétences professionnelles par lequel le membre du personnel s’engagent à atteindre certains objectifs (maximum 4), notamment par le biais de formations, de collaboration avec les pairs, etc. Après une période pouvant aller de 6 mois à 2 ans, la direction (ou le délégué susvisé) fait le point sur la mise en œuvre des objectifs contractualisés. En cas de mauvaise volonté manifeste du membre du personnel à mettre en œuvre lesdits objectifs auxquels il s’est engagé ou en cas de manquements répétés, la direction peut dresser un rapport motivé au pouvoir organisateur qui l’invite à procéder à une évaluation. Ce second volet consiste en une audition du membre du personnel au terme de laquelle est dressé un plan d’accompagnement individualisé dans le cadre duquel le membre du personnel s’engage, vis-à-vis de son pouvoir organisateur cette fois, à atteindre certains objectifs professionnels (maximum 4). Au terme d’un délai pouvant aller de 6 mois à 2 ans de nouveau, le pouvoir organisateur fait le point avec le membre du personnel et lui attribue une mention favorable ou défavorable. En cas de commun accord entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel, une prolongation entre 3 mois et un an est envisageable si des améliorations sont constatées dans le chef du membre du personnel sans pour autant atteindre l’ensemble des objectifs professionnels fixés. Une mention défavorable, susceptible de recours auprès d’une Chambre de recours, fait obstacle à la nomination d’un agent temporaire prioritaire mais n’impacte pas la carrière d’un agent nommé à titre définitif. Une seconde mention défavorable consécutive, également susceptible de recours auprès de la chambre de recours, met fin aux fonctions du membre du personnel auprès du pouvoir organisateur concerné et uniquement dans la fonction soumise à évaluation, que l’agent soit désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif.
L’entrée en vigueur de cet avant-projet de décret était initialement prévue pour la rentrée scolaire 2022-2023, mais a été reportée à janvier 2024. A cette date, le 1er volet de l’évaluation (développement des compétences professionnelles) est entré en vigueur tandis que le second volet n’entrera en vigueur qu’à la rentrée scolaire 2026-2027. Ainsi, des entretiens de fonctionnement avec les directions d’école (ou leur délégué) peuvent se tenir et des plans de développement des compétences professionnelles peuvent être rédigés. En revanche, aucune évaluation par le pouvoir organisateur ne peut à ce stade prendre place. Par ailleurs, une période transitoire est prévue jusque l’année scolaire 2026-2027 permettant à tous les évaluateurs concernés (directions, délégués et membres du pouvoir organisateur[2]) de se former adéquatement. Dans l’attente de la formation de l’ensemble des membres du personnel, en avril 2024, le CECP a organisé des séances d’information à destination des pouvoirs organisateurs pour les informer des grandes lignes directrices de ce nouveau dispositif d’évaluation (principes du pacte, balises réglementaires pour la mise en œuvre du soutien et du développement des compétences professionnelles, importances de la formation des directions et des pouvoirs organisateurs, etc.).
5. Lutte contre la pénurie
Dans sa déclaration de politique communautaire 2019-2024, le Gouvernement de la Communauté française s’était engagé à rencontrer le problème de la pénurie des enseignants. Durant l’année scolaire 2023-2024, des mesures ont à nouveau été adoptées pour lutter, autant que possible, contre la pénurie à court terme.
A. Dispositif expérimental du pool local de remplacement
Le décret du 1er décembre 2022 instituant un dispositif expérimental créant un pool local de remplacement pour l'année scolaire 2022-2023 et contenant des mesures diverses en vue de lutter contre la pénurie d'enseignants[3] a prévu la possibilité de mettre en place, au sein des Pouvoirs organisateurs des zones de Bruxelles-Capitale et de Hainaut Sud[4], un pool local de remplacement expérimental pour la période du 1er décembre 2022 au 7 juillet 2023.
A la suite de l’évaluation réalisée par le Gouvernement sur la rencontre des objectifs visés et sur son impact budgétaire l’expérience pilote a été prolongée, selon les mêmes modalités et pour les mêmes Pouvoirs organisateurs, pour la période du 28 août 2023 au 5 juillet 2024.
Les évaluations du dispositif durant l’année scolaire 2022-2023 et durant les premiers mois de l’année scolaire 2023-2024 ayant démontré que les acteurs de terrain participant au dispositif en sont majoritairement satisfaits et eu égard à la pénurie récurrente, il a été décidé de prolonger le dispositif expérimental pour l’année scolaire 2024-2025.
B. Dispositif expérimental de recrutement d’experts dans l’enseignement obligatoire
Pendant une durée de deux années scolaires (2024-2025 et 2025-2026), il est permis de faire appel, dans des emplois relevant de fonctions déterminées – tels que les maîtres de seconde langue dans l’enseignement fondamental – ne pouvant être pourvus dans le cadre des procédures statutaires, faute de candidats, à un membre du personnel dans le cadre d’un emploi d’expert, similaire pour ce qui concerne les modalités de rémunération à ce qui se fait dans l’enseignement de promotion sociale.
Ce dispositif permet de connecter le monde du travail à celui de l’enseignement. Ce « statut » d’expert est plus valorisant/attractif que celui de « titre de pénurie non listé ». Le mécanisme a pour objectif de s’adresser à de nouveaux profils d’enseignants et d’enseignantes, attirés par un système permettant de combiner une fonction dans l’enseignement et une fonction dans un autre secteur. Ce dispositif peut également rencontrer les aspirations personnelles de certains travailleurs issus d’autres secteurs en termes notamment d’engagement social ou de recherche de sens.
Le recrutement d’experts ne doit pas être privilégié par rapport au recrutement statutaire d’enseignants. Les règles statutaires en matière de dévolution des emplois doivent donc toujours être respectées, avant de pouvoir recruter, en situation de pénurie, un expert. Il s’agit donc d’une mesure de lutte contre la pénurie d’enseignants dans des domaines particuliers, à court terme, et, à long terme, pour susciter nouvelles vocations.
6. Mise en œuvre progressive du Tronc commun dans les écoles
Le tronc commun poursuivra l’année prochaine son entrée en vigueur progressive dans l’enseignement fondamental. En 2024-2025, il concernera ainsi tous les élèves inscrits de la première maternelle à la cinquième primaire. De nouvelles règles et de nouveaux dispositifs intégrés au Code de l’enseignement sont d’application depuis la rentrée scolaire. De nouveaux moyens d’encadrement sont calculés.
Le référentiel de compétences initiales est mis en œuvre depuis l’année scolaire 2020-2021, porte sur l’enseignement maternel. Les neuf référentiels disciplinaires portent quant à eux sur les apprentissages de la 1e primaire à la 3e secondaire.
A. Principales nouveautés pour l’année scolaire 2024-2025
- Nouveaux domaines d’apprentissage et nouvelle grille horaire indicative en P5
- Intégration de 3 périodes d’éducation physique et à la santé (EPS) dans l’horaire hebdomadaire des élèves de P5
- Intégration de 4 périodes (en P1 et P2) et de 2 périodes (en P3, P4 et P5) d’accompagnement personnalisé dans l’horaire hebdomadaire des élèves
- Procédure de maintien exceptionnel pour les élèves de M3 à la P5 (numérisation de la procédure dans le DaccE).
B. L’accompagnement personnalisé
1. Objectifs
Le tronc commun vise à assurer à chaque élève un accompagnement personnalisé à même de mieux appréhender les besoins et difficultés d’apprentissage. Cet accompagnement personnalisé se traduit par une différenciation pédagogique ou didactique dans l’appréhension des apprentissages.
2. Moyens complémentaires
À partir de l’année scolaire 2024-2025, chaque implantation reçoit 1 période par tranche entamée de 5 élèves sur base de la population scolaire cumulée de P1-P2 et 1 période par tranche entamée de 20 élèves du 15 janvier précédent (recomptage au 30 septembre en cas de variation de 5% de la population primaire par commune). En P3P4, les deux périodes dégagées par le cours de langue moderne permettent d’organiser l’accompagnement personnalisé.
C. Le renforcement du cours de langue moderne dans les communes wallonnes de langue française
1. Objectifs
Renforcer l'apprentissage d’une deuxième dans l'enseignement est essentiel pour préparer les élèves à un monde de plus en plus connecté, pour favoriser la compréhension interculturelle et pour stimuler le développement intellectuel.
2. Mise en œuvre
Au niveau maternel et en P1-P2, une activité de découverte visant à explorer et comparer une variété de langues, de sonorités et de cultures est mise en place et confiée au titulaire de la classe. Depuis l’année scolaire 2023-2024, un cours de langue moderne I est organisé dès la P3 pour tous les élèves. Ce nouveau parcours est soutenu par un nouveau calcul d’encadrement.
3. Moyens complémentaires
Depuis de l’année scolaire 2023-2024, chaque implantation reçoit 2 périodes par tranche entamée de 23 élèves sur base de la population scolaire cumulée de la P3 à la P6 certifiée au 15 janvier précédent (un recomptage au 30 septembre est prévu en cas de variation de 5% de la population primaire par commune).
7. Bâtiments scolaires
A. Programme Prioritaire de Travaux (PPT)
Le décret du 16 novembre 2007 organise le Programme prioritaire de Travaux. Celui-ci, entré en vigueur le 1er janvier 2008, s’applique aux bâtiments scolaires de l’enseignement obligatoire, de l’enseignement secondaire de promotion sociale, de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit, des centres psychomédicosociaux et des internats. Il a pour objectif de remédier aux situations qui sont préoccupantes du point de vue de la sécurité, de l’hygiène et/ou de la performance énergétique et qui nécessitent une réaction rapide en raison de la dégradation, de la vétusté ou de l’inadaptation des infrastructures.
Toutefois, ce programme sera prochainement remplacé par un nouveau mécanisme de travaux ponctuels.
En cette période transitoire, le CECP tient, dans le cadre du dispositif précité, un quadruple double rôle, à savoir :
- Aider les pouvoirs organisateurs dans la constitution le suivi de leurs dossiers éligibles.
- Défendre les intérêts des provinces et des communes en soutenant ces mêmes dossiers lors de leur examen pour approbation
À noter qu’en vertu d’un accord conclu entre le CPEONS et le CECP, ce dernier a été chargé de la gestion du dossier « bâtiments scolaires » pour l’ensemble du réseau, quel que soit le niveau d’enseignement.
1. Bilan du budget PPT 2023
En 2023, le PPT a été alimenté par un budget de 19.049.039,93 € en termes de subsides.
55 dossiers ont été défendus par le CECP à la Commission Inter Caractère et ont reçu un avis favorable permettant ainsi la consommation des moyens de l’Officiel subventionné au budget PPT 2023 à savoir 16.413.671,96 € en termes de subsides.
Un solde du budget PPT 2023 de 2.636.367,97 € a été reporté au budget PPT 2024.
2. Situation du budget PPT 2024
D’après la situation financière du 25 mars 2024, le montant indexé des moyens octroyés à l’enseignement Officiel subventionné au budget annuel PPT 2024 est de 21.454.587,44 € en termes de subsides (budget PPT 2024 18.819.219,47 € + report budget PPT 2023 2.635.367,97 €).
Depuis le 1er janvier 2024, le CECP a défendu 59 dossiers de l’Officiel subventionné, qui ont tous reçu un avis favorable de la Commission Inter Caractère.
Au 18 septembre 2024, la consommation du budget PPT 2024 s’élève à 15.909.281,19 € en termes de subsides soit 78,22 % du budget. Deux Commissions Inter Caractère auront lieu le 15 octobre 2024 et le 19 novembre 2024. Le solde disponible au 24 septembre 2024 au budget PPT 2024 est de 4.672.834,38 €.
Par le décret du 16 mai 2024 relatif au financement des bâtiments scolaires, les articles 7, 7/1 et 7/2 du décret du 16 novembre 2007 relatifs aux moyens dédiés au programme prioritaire de travaux sont abrogés au 1er janvier 2025. Le mécanisme du programme prioritaire de travaux reste toutefois fonctionnel afin de permettre aux derniers dossiers éligibles en cours d’être finalisés.
Les moyens nécessaires au financement des dossiers disposant déjà d’un accord d’éligibilité au programme prioritaire de travaux seront ponctionnés sur les ressources prévues pour le CECP et pour le CPEONS au sein du réseau officiel subventionné à l’article 7 du décret du 5 février 1990 tel que modifié par le décret du 16 mai 2024. Ces moyens seront octroyés à condition que les dossiers concernés obtiennent un accord ferme de subvention.
Les nouveaux mécanismes de subventionnement décrits dans le décret du 16 mai 2024 devraient être mis en oeuvre en 2025. Dans le cadre de cette réforme, un arrêté du Gouvernement de la Communauté française est en cours d’élaboration.
A l’heure actuelle, tous les dossiers en liste d’attente au PPT sont conservés et dès que le CECP aura connaissance de l’AGCF concernant les nouveaux mécanismes, les pouvoirs organisateurs seront informés pour orienter leurs candidatures PPT déjà introduites vers le dispositif le plus adéquat.
B. Fonds de Garantie des bâtiments scolaires
Le fonds de garantie des bâtiments scolaires est géré par un conseil de gestion où siègent des représentants du Gouvernement, de l’enseignement libre subventionné et de l’enseignement officiel subventionné.
Lors de la séance du 20 février 2024, le conseil de gestion a défini un ordre de priorité dans le traitement des dossiers de demande de prêt garanti :
1° PPT ;
2° PRR ;
3° CP ;
4° Autres demandes selon les possibilités budgétaires.
Lors de la séance du 16 avril 2024, afin de préserver la capacité d’emprunt, le conseil de gestion a pris les décisions suivantes :
- la provision des prêts garantis est réduite à 10% pour tous les programmes de subvention (PPT, CP, FBSEOS, FG) sauf pour le PRR pour lequel la provision est maintenue à 15%.
- pour les dossiers du Programme prioritaire de travaux, la provision reste calculée non pas sur la part en emprunt, mais sur le montant d’investissement.
Ces mesures seront évaluées régulièrement par le Conseil de Gestion.
C. Décret relatif au plan d’investissement dans les bâtiments scolaires dans le cadre du plan de reprise et résilience européen (PRR)
Dans le cadre du plan de reprise et de résilience européen de la Communauté française, 269 millions sont consacrés à un plan d’investissement pour les bâtiments scolaires.
Dans ce plan d’investissement, une attention particulière est apportée à la transition énergétique, mais aussi aux objectifs de transition numérique, d’inclusion, d’intégration du tronc commun, du parcours d’éducation culturelle et artistique, de mutualisation des espaces et de collaboration infrastructurelle inter-réseaux.
Le Décret PRR définissant ce plan d’investissement a été adopté le 30 septembre 2021 (M.B. 21-10-2021) et modifié le 28 avril 2022 (M.B. 27-06-22).
La circulaire 8291 fixant la procédure d’octroi de ce financement a été publiée le 1er octobre 2021.
Pour le CECP/CPEONS, 60 candidatures ont été retenues pour un montant de 125.301.787,25 € soit 46,57 % des moyens alloués.
Au 24 septembre 2024, trois dossiers ont été abandonnés, tous les autres dossiers sont maintenus.
La plupart des dossiers sont au stade de la demande d’accord ferme, plusieurs dossiers ont reçu leur octroi d’accord ferme et ont notifié les travaux.
Le délai de réception provisoire est imposé par l’Union européenne et est fixé au 30 juin 2026.
D. Décret relatif au plan d’investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires (PIE)
Dans le cadre du plan d’investissement exceptionnel de la FWB, 1 milliard est dédié aux bâtiments scolaires à l’exception des universités.
Le Décret PIE définissant ce plan d’investissement exceptionnel a été adopté par le Parlement de la FWB le 27 avril 2023 (M.B. 30-05-2023).
L’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret PIE a été adopté le 1er juin 2023 (M.B. 22-06-2023).
Les travaux visés doivent s’inscrire dans les enjeux suivants :
- Amélioration de l’état du bâtiment : remédier à la vétusté et aux situations problématiques (instabilité, amiante…), améliorer les conditions d’apprentissage et le bien-être des élèves et des enseignants ;
- Transition énergétique des bâtiments : améliorer l’isolation, installer des systèmes de chauffage décarbonés, réaliser un audit de réemploi des matériaux, limiter la bétonisation et favoriser la verdurisation ;
- Mise en œuvre du Pacte pour un Enseignement d’excellence : adapter les espaces aux besoins pédagogiques des utilisateurs, répondre aux exigences de la connectivité, réaliser un audit d’accessibilité et d’inclusion et suivre les recommandations de celui-ci, développer les mutualisations des espaces et les collaborations infrastructurelles inter-pouvoirs organisateurs ou inter-réseaux ainsi que la création d’infrastructures adaptées au déploiement du tronc commun.
L’objet de la subvention reprend les travaux suivants :
- La rénovation d’un bâtiment qui est ou sera utilisé à des fins scolaires ;
- La démolition totale ou partielle et sa reconstruction, il faudra cependant prouver que la rénovation est impossible ;
- En complément des travaux précités, le renforcement de la capacité d’accueil est permis si le projet est situé dans une zone en tension démographique.
Le taux de subvention de base s’élève à 65% et peut atteindre 70% suivant certaines conditions à respecter.
Ce plan d’investissement est décliné en plusieurs appels à projets avec pour les trois premiers appels une enveloppe budgétaire définie :
1. Appel à projets
Pour tout appel à projet, les pouvoirs organisateurs doivent constituer leurs dossiers de candidatures et devront l’introduire sur une plateforme numérique dédiée à cet appel dont l’ouverture sera annoncée par voie de circulaire.
Chaque candidature devra respecter les modalités de cet appel et s’engager à respecter les conditions d’éligibilité définies dans la circulaire.
Afin d’être recevable, une candidature doit contenir :
- Les données suivantes :
- Les données d’identification sollicitée par la plateforme
- La délibération du PO relative à la décision d’entreprendre les travaux introduits au PIE
- Le plan cadastral de la parcelle visée par la demande
- Si démolition, la note justifiant l’impossibilité de la rénovation
- Un reportage photographique du bâtiment visé par la demande
- L’estimation par postes globaux
- Tout élément permettant la parfaite compréhension du projet
- Les éléments permettant de vérifier les conditions d’éligibilité requises à la candidature :
- Le descriptif des travaux et du programme envisagé
- L’outil de valorisation du bâtiment existant appelée également « matrice » à compléter entièrement pour que le dossier soit mieux priorisé
- Les plans simplifiés du bâtiment existant
- L’engagement de respecter les conditions d’éligibilité qui devront être remplies à une étape ultérieure
- Les documents liés aux critères de priorisation
Des critères de priorisation sont mis en place afin d’être en mesure de départager les dossiers si les demandes dépassent l’enveloppe budgétaire prévue.
Les critères de priorisation sont :
- La valorisation de l’état du bâtiment (outil « matrice » complété entièrement)
- Un bâtiment touché par les inondations de juillet 2021
- Le dépôt d’un audit énergétique agréé
Le CECP, en collaboration avec le CPEONS, a mesuré la complexité du dispositif et a décidé d’informer, d’accompagner et de soutenir les pouvoirs organisateurs pendant l’élaboration des candidatures.
Plusieurs actions ont été mises en place :
- Rédaction de documents informatifs (powerpoint, bulletins d’informations) ;
- 1 visioconférence en mai 2023 ;
- 4 séances d’informations en présentiel dans les différentes régions/provinces en juin 2023 ;
- Soutien et accompagnement par mailing, téléphone, visioconférence et/ou en présentiel.
2. Classement des dossiers
La complétude des critères de priorisation par le PO attribue à chaque dossier un auto-score provisoire généré automatiquement par la plateforme électronique.
Les projets sont mis en concurrence tous réseaux confondus et classés suivant l’auto-score provisoire.
Si, après vérification de l’administration du Service général des Infrastructures scolaires subventionnées, le dossier est classé en ordre utile, il reçoit un accord d’éligibilité.
3. Etat des lieux
a. Appel 1
La circulaire 8938 et ses annexes du 5 juin 2023 fixe la procédure du premier appel à projets à destination des pouvoirs organisateurs de l’enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l’enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR) et des centres PMS, internats et homes d’accueil pour un montant de 300.000.000 euros.
La circulaire 9056 du 28 septembre 2023 informe de l’ouverture de la plateforme électronique.
Cet appel a eu lieu du 5 juin au 20 octobre 2023.
A la clôture de l’appel 1, 200 candidatures ont été introduites pour l’enseignement officiel subventionné et représentaient un montant en termes de subside de 369.054.983,92 €.
Conformément aux conditions et aux critères d’éligibilité, de priorisation et de départage énoncés dans le décret PIE du 27/04/2023, sur les 479 dossiers candidatures introduits tous réseaux confondus, qui ont été analysés et classés par le service général des infrastructures scolaires subventionnées, seuls 40 dossiers ont pu être retenus au vu de ladite enveloppe. Le 31 mai 2024, le Gouvernement de la Communauté française a arrêté la liste définitive des dossiers retenus :
- Pour le réseau de l’enseignement officiel subventionné, 7 dossiers ont été sélectionnés pour un montant total de +/- 29.000.000 d’euros.
- Pour le réseau de l’enseignement libre subventionné, 11 dossiers ont été sélectionnés pour un montant total de +/- 22.000.000 d’euros.
- Pour Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), 22 dossiers ont été sélectionnés pour un montant total de +/- 249.000.000 d’euros.
A titre informatif, après la validation du classement par le Gouvernement, il s’avère que le score minimal à atteindre pour être retenu lors de ce 1er appel, s’élève à 32,37 points.
Vu le déséquilibre des résultats du 1er appel entre les réseaux subventionnés et WBE, et vu la volonté du législateur d’éviter qu’un groupe de pouvoirs organisateurs puisse se sentir mis de côté par l’action menée par la Communauté française, une première modification au décret PIE du 27/04/2023 a été apportée.
Afin d’envisager une prise en compte large et plurielle des besoins des pouvoirs organisateurs en termes de bâtiments scolaires, un plafond maximum a été fixé par réseau d’enseignement. Celui-ci tient compte de la proportionnalité de la démographie scolaire au sein de chaque réseau en se basant sur le poids scolaire de l’année scolaire 2019.
Ce plafond correspond pour chaque réseau, à l’équivalent de 2 fois son poids scolaire.
Ledit plafond est appliqué sur les moyens globaux alloués aux 2ème, 3ème et 4ème appels à projets uniquement, et ce, au vu du fait que le 1er appel est à présent entériné par le Gouvernement.
Ces plafonds sont les suivants :
- Pour l’enseignement officiel subventionné CECP/CPEONS : 79 %
- Pour l’enseignement libre subventionné SeGEC/FELSI : 90 %
- Pour l’enseignement organisé WBE : 32%
b. Appel 2
La circulaire 9106 et ses annexes du 27 novembre 2023 fixe la procédure du deuxième appel à projets à destination des pouvoirs organisateurs de l’enseignement supérieur hors universités et de l’enseignement supérieur de promotion sociale en ce compris les internats relevant de l’enseignement supérieur pour un montant de 200.000.000 euros.
La circulaire 9140 du 24 janvier 2024 informe de l’ouverture de la plateforme électronique.
Cet appel a eu lieu du 27 novembre 2023 au 12 mars 2024.
A la clôture de l’appel 2, 7 candidatures ont été introduites pour l’enseignement officiel subventionné et représentent un montant en termes de subside de 43.944.121,32 €.
Les candidatures sont toujours à l’analyse et les résultats sont attendus pour le 15 octobre 2024.
c. Appel 3
La circulaire 9213 et ses annexes du 29 mars 2024 fixe la procédure du troisième appel à projets à destination des pouvoirs organisateurs de l’enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l’enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR) et des centres PMS, internats et homes d’accueil pour un montant de 200.000.000 euros.
La circulaire 9271 du 4 juin 2024 informe de l’ouverture de la plateforme électronique.
Cet appel a eu lieu du 29 mars au 17 septembre 2024.
A la clôture de l’appel 3, 219 candidatures ont été introduites pour l’enseignement officiel subventionné et représentent un montant en termes de subside de 393.689.919,01 €.
Les candidatures sont à l’analyse et les résultats sont attendus pour le premier trimestre 2025.
8. Pôles territoriaux
A. Contextualisation
Dans le cadre du Pacte pour un Enseignement d’Excellence (avis n° 3 du Groupe central), et singulièrement du décloisonnement de l’enseignement spécialisé, une réforme importante du mécanisme d’intégration et une évolution de l’école ordinaire vers un modèle plus inclusif ont été programmées.
À cette fin, la création de pôles territoriaux par entité géographique s’est établie en septembre 2021, pour une mise en œuvre progressive à la rentrée 2022.
Depuis cette date, les pôles territoriaux accompagnent progressivement les écoles de l’enseignement ordinaire avec lesquelles ils ont contractualisé. En effet, en tant que centre de ressources, chaque pôle territorial mettra son expertise au service des élèves et des membres du personnel de ces écoles ordinaires, notamment en fournissant un accompagnement à la mise en place des aménagements raisonnables et en assurant le suivi des intégrations permanentes totales, afin de maintenir, autant que faire se peut, les élèves à besoins spécifiques dans l’enseignement ordinaire, ceci dans l’esprit de la démarche évolutive qui fonde l’école inclusive. De cette manière, ils tentent, d’une part, de renforcer l’expertise des équipes éducatives de l’enseignement ordinaire, à partir de l’expertise développée dans l’enseignement spécialisé, et d’autre part, de favoriser l’inclusion des élèves à besoins spécifique dans l’enseignement ordinaire.
B. Actions du CECP
Au vu de l’ampleur des enjeux de la mise en place des pôles territoriaux, le CECP a pris les devants en réunissant, dès septembre 2020, les acteurs qui, au niveau des pouvoirs organisateurs, assuraient la coordination des projets et des périodes d’intégration pour identifier avec eux les bonnes pratiques de terrain pouvant nourrir la réflexion sur le projet de création de pôles.
En parallèle, afin de défendre au mieux le principe de neutralité qui fait la spécificité de notre réseau, le CECP a organisé plusieurs réunions avec le CPEONS, WBE et la FELSI afin d’envisager, dans chaque zone, la création d’un ou plusieurs pôle(s) non confessionnel(s). Dans le cadre de ces réunions, un groupe de travail a été organisé et a permis d’établir des modèles de pré-conventions de partenariat et de coopération dans l’attente de l’adoption du projet de décret et, partant, des modèles définitifs de conventions.
Entre ces séances d’informations et la date de dépôt des candidatures à la création d’un pôle, le CECP a accompagné les PO du réseau officiel subventionné désireux de créer un pôle via l’organisation de rencontres au niveau de certaines zones, une facilitation des contacts entre PO, la mise à disposition d’outils d’informations permettant aux PO candidats à la création d’un pôle de présenter l’offre de base aux écoles coopérantes.
Par ailleurs, le Cabinet de la ministre de l’Éducation a alloué, au réseau officiel subventionné, 6 emplois de coordinateurs de pôle dans le cadre de la préfiguration des pôles. Les équipes du CECP ont encadré ces coordinateurs-pilotes en se basant sur l’expérience développée par quelques pouvoirs organisateurs dans le cadre de la gestion et de la mutualisation des périodes d’intégration.
A la rentrée scolaire 2021-2022, 13 pôles ont été créés pour le réseau officiel subventionné. Depuis cette date, ceux-ci sont accompagnés collectivement et individuellement par le CECP. Des rencontres collectives entre pouvoirs organisateurs et coordonnateurs de pôle sont organisées afin de leur fournir des aides dans la mise en œuvre de leur pôle territorial en rappelant le cadre législatif, en répondant à leurs questions, en les accompagnant dans la rédaction de document, etc. Les rencontres individuelles visent davantage à échanges sur les problématiques de terrain et à tenter d’y apporter des réponses.
En outre, en 2022-2023, le CECP a été particulièrement attentif à la rédaction d’un règlement de travail applicable aux membres des équipes pluridisciplinaires des pôles territoriaux et a abouti, en mai 2023, à un texte, concerté avec les organisations syndicales de l’enseignement officiel subventionné, dont l’entrée en vigueur a été prévue à la rentrée scolaire 2023-2024. En attente de la force obligatoire accordée par le Gouvernement, le modèle de règlement de travail avait toutefois été communiqué aux pouvoirs organisateurs concernés afin de leur permettre de préparer au mieux la rentrée scolaire 2023-2024. Ce texte a désormais été publié au Moniteur belge[5].
Enfin, le CECP a élaboré et dispensé la formation des coordonnateurs de pôle qui doivent disposer d’une attestation de suivi de cette formation pour obtenir une nomination dans cette nouvelle fonction. Des formations ont débuté au printemps 2023 par les volets pédagogique et relationnel et s’est clôturée au printemps 2024 par le volet législatif et la certification des coordonnateurs de pôle.
9. Exclusions définitives d’élèves
L’avis n°3 du Pacte pour un Enseignement d’Excellence prévoit que « étant donné leurs répercussions importantes sur la scolarité et la vie familiale, tant l’exclusion que le refus de réinscription doivent également être appréhendés dans le cadre global du fonctionnement (ou des dysfonctionnements) du système scolaire, et des mécanismes de relégation auxquels peut s’identifier le recours à ces deux mesures qui devraient normalement constituer la sanction ultime ». Dans ce cadre, ce texte avait identifié en particulier les enjeux suivants : parer à l’éclatement des sources juridiques, mieux circonscrire les faits pouvant conduire à une procédure d’exclusion définitive, travailler sur la suppression de l’exclusion au niveau maternel et au début du primaire, créer une chambre inter-réseaux pour connaître des recours contre les décisions d’exclusion, etc.
Le décret du 16 mai 2024, publié au Moniteur belge du 22 juillet 2024, vise à concrétiser les mesures précitées.
Ce texte entre en partie en vigueur dès l’année scolaire 2024-2025 tandis que d’autres mesures qu’il contient entreront en vigueur à la rentrée scolaire 2025-2026.
En ce qui concerne les mesures qui sont d’application à partir de la rentrée scolaire 2024-2025 :
- Dans l’enseignement maternel, un élève ne pourra plus être exclu définitivement sauf s’il s’est rendu coupable de coup et blessure portés sciemment par un élève à un autre élève, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité, même limitée dans le temps, de suivre les cours ;
- Dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire, un élève ne pourra plus être exclu définitivement que si les faits dont il s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettant gravement l’organisation ou la bonne marche de l’école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave ;
- Il sera par principe interdit d’exclure définitivement un élève après le 15 mai. Après cette date, seule une procédure de refus de réinscription pourra en effet être entamée sauf si les faits qui lui sont reprochés sont repris dans une liste exhaustive ;
- Lorsque le PO a délégué à la direction la compétence d’exclure définitivement un élève, le texte prévoit que l’acte de délégation du PO en faveur de son délégué organise les modalités de la délégation, notamment, le cas échéant, la possibilité d’un droit d’évocation de la part du PO en vue de l’adoption d’une décision d’exclusion définitive.
- L’école qui aura exclu un élève devra fournir aux parents de ce dernier s’il est mineur ou à l’élève lui-même s’il est majeur âgé de 18 à 21 ans inscrit dans une 5e , 6e ou 7e de l’enseignement secondaire ordinaire ou de l’enseignement secondaire spécialisé de forme 4, les supports pédagogiques nécessaires à la continuité des apprentissages et fixe, le cas échéant, les modalités de présentation de travaux personnels et d’examens de manière à ce que l’élève bénéficie de possibilités de sanction des études comparables à celles des autres élèves. Cet accompagnement est mené jusqu’à la réinscription de l’élève exclu dans une autre école de l’enseignement obligatoire, dans une école d’enseignement de promotion sociale ou dans tous types de dispositifs qui permettent de satisfaire à l’obligation scolaire. Pour les élèves majeurs, cet accompagnement prend également fin s’ils ont trouvé un emploi, entamé une formation professionnelle ou s’ils ont y ont mis un terme à leur initiative. Dans tous les cas, cet accompagnement prend fin le dernier jour de l’année scolaire en cours.
La mise en place de chambres inter-réseaux amenées à connaître des recours contre les décisions d’exclusion définitive est, quant à elle, prévue pour l’année scolaire 2025-2026.
10. Taille des classes
Le protocole sectoriel 2021-2024 relatif à l’enseignement a prévu, sans préjudice de la trajectoire budgétaire générale, d’analyser et de formuler des propositions concrètes quant aux règles relatives à la taille des classes, au départ notamment d’une objectivation du recours aux mécanismes de dérogation légalement prévus, et ce dans un objectif d’optimalisation des moyens.
Afin de concrétiser cet objectif, le décret portant diverses mesures relatives à la taille des classes dans l'enseignement obligatoire a été voté en séance plénière du Parlement de la Communauté française le 25 avril 2024.
Le décret met fin au système de dérogations automatiques.
Dans l’enseignement maternel, le décret introduit un nombre maximum d’élèves par groupe d’élèves réunis sous la supervision d’un enseignant. Ce nombre est fixé entre 22 et 24 élèves maximum par groupe-classe. Un dépassement de cette nouvelle norme implique la remise d’un avis systématique de la COPALOC.
Dans l’enseignement primaire, le décret prévoit le maintien des normes actuelles, mais plus aucun dépassement automatique ne sera autorisé sans demande d’avis préalable auprès de la COPALOC.
Concrètement, les pouvoirs organisateurs devront désormais indiquer les raisons de tout dépassement.
11. Octroi des aides complémentaires
Le décret du 4 avril 2024 relatif aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement bénéficiant des subventions régionales, abrogeant diverses dispositions en matière d'enseignement fondamental et secondaire et modifiant diverses dispositions relatives aux puériculteurs a pour objets d’apporter une assise législative aux aides complémentaires dans le secteur de l’enseignement bénéficiant des subventions régionales, d’améliorer le mécanisme d’attribution des postes dans l’enseignement obligatoire et de modifier diverses dispositions tendant à harmoniser le traitement de la fonction de recrutement de puériculteurs.
Dans ce texte, il est précisé que le Ministre de l’Éducation affecte au minimum 984 postes aux puériculteurs non statutaires, entre 150 et 250 postes à des fonctions liées au soutien aux directions, ainsi que 13 postes et demi afin de renforcer l’encadrement des écoles dans le cadre de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l’enseignement. Cinquante postes complémentaires peuvent également être attribués, sous réserve de l’approbation du gouvernement, pour des situations de force majeure, des situations exceptionnelles ou des situations non couvertes par les données à disposition.
Ces postes sont répartis, pour chaque Région, sur la base de la population scolaire au premier comptage de l’année scolaire d’attribution par niveau, type d’enseignement, réseau et zone.
Tous les deux ans, les pouvoirs organisateurs introduisent leur demande auprès des Services du gouvernement, et ce, pour chacune de ses implantations. Un principe de mutualisation (entre implantations ou entre pouvoirs organisateurs) peut être sollicité pour les fonctions autres que puériculteur.
Chaque Commission effectue le classement des implantations par niveau et par type d’enseignement, par réseau et par zone, en appliquant ces critères, par ordre de priorité :
1° la présence d’une classe unique ;
2° le ratio élevé du taux d’encadrement dans le niveau concerné ;
3° l’indice socioéconomique ;
4° les besoins spécifiques des élèves ;
5° la population scolaire ;
6° les facteurs liés à l’environnement de l’élève.
Après examen du classement, la Commission peut apporter une modification “à la marge” de celui-ci. L’arbitrage de la Commission ne peut se faire que si la justification prend en compte au moins un de ces éléments :
- des éléments structurels spécifiquement liés à l'implantation, susceptibles de justifier le besoin d'une aide complémentaire ;
- des besoins des élèves et de l'établissement dans le respect des droits et des intérêts du membre du personnel ;
- du nombre excessif de demandes émanant d'une même implantation.
Une fois le classement validé par chaque Commission, le Ministre attribue les postes pour deux années scolaires et en informe le pouvoir organisateur au plus tard le dernier jour de l’année scolaire qui précède l’année scolaire pour laquelle la demande est formulée.
Dans la mesure ou lorsqu’un pouvoir organisateur renonce à un poste ou ne procède pas à l’engagement après trois mois sans en communiquer les motifs, le poste est attribué à l’implantation la mieux classée suivante.
12. Lutte contre le décrochage scolaire
L’ambitieux décret relatif à la réduction du décrochage scolaire et à la lutte contre l'absentéisme des élèves adoptée en séance plénière du Parlement de la Communauté française le 25 avril 2024 devra être mis en œuvre dans les établissements scolaires au cours des trois prochaines années scolaires.
En bref, le dispositif se fonde sur une signalisation plus rapide de l’absentéisme, via une application informatique, appelée App100, destinée à remplacer à terme les registres de présence papier, pour une prise en charge plus efficace du décrochage.
Dans chaque école, un membre de l’équipe éducative sera par ailleurs désigné comme « garant de l’accrochage scolaire », devant veiller notamment à la mise en place du processus de suivi des élèves en situation de décrochage.
En fonction du nombre de jours d’absence injustifiée, la procédure à l’égard de ces élèves s’établit en trois axes :
1° Axe 1 : l’élève en situation d’absentéisme prolongé fait l’objet d’un suivi et d’un accompagnement dans le cadre d’un soutien précoce ;
2° Axe 2 : l’élève en risque de décrochage scolaire fait l’objet d’un suivi et d’un accompagnement dans le cadre d’une intervention ;
3° Axe 3 : l’élève en situation de décrochage scolaire fait l’objet d’un suivi et d’un accompagnement dans le cadre d’une compensation.
L’application de ces trois axes est évidemment progressive.
Pour chacun des axes visés il est prévu l’intervention :
1° d’un pilote dont la mission est d’assurer le suivi de l’élève concerné conformément aux dispositions applicables pour chacun des axes ;
2° d’un ou plusieurs intervenant(s) dont la mission porte sur l’accompagnement de l’élève concerné, là encore conformément aux dispositions applicables pour chacun des axes ;
Si l’essentiel de la mise en place de ce système est prévu pour les années scolaires 2025-2026 et 2026-2027, les premiers jalons concerneront déjà l’année scolaire 2024-2025.
Ainsi, d’une part, les directions et les équipes éducatives devront mettre en place une prévention collective du décrochage scolaire au sein de l’école, visant les actions minimales destinées à favoriser l’accrochage et prévenir le décrochage scolaire pour l’ensemble des élèves, et d’autre part, il conviendra de désigner un « garant de l'accrochage scolaire » au sein de chaque école dès le second semestre de cette année. C’est une obligation dans l’enseignement secondaire, une faculté dans l’enseignement fondamental.
Il est par ailleurs créé, au niveau de l’Administration Générale de l’Enseignement (AGE), un service intégré d’assistance aux écoles qui entrera également en action dès l’année scolaire 2024-2025.
13. Climat scolaire et lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement
Le Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire a été modifié durant l’année scolaire écoulée, intégrant un dispositif visant à l'amélioration du climat scolaire et, en particulier à la prévention du harcèlement et du cyberharcèlement au sein de l’école. Chaque école doit désormais établir une procédure spécifique de signalement interne et de prise en charge des situations de harcèlement et de cyberharcèlement scolaires.
Cette procédure doit notamment préciser :
1° les modalités d'enregistrement du signalement des faits,
2° les étapes de la procédure, du signalement jusqu'au traitement ;
3° les délais maximums de traitement du signalement ;
4° l'identification des personnes relais au sein de l’école ou en dehors.
Ladite procédure devait être décrite dans le règlement d'ordre intérieur respectif de chaque école pour le 26 août 2024, pour une mise en œuvre effective durant la présente année scolaire.
[1] Un enseignant expérimenté est un enseignant disposant d’une ancienneté de plus de 15 ans dans l’enseignement et n’ayant pas obtenu de rapport d’évaluation défavorable.
[2] Il s’agit d’une obligation dans le chef des directions d’école et du délégué, si la mission lui est confiée.
[3] M.B. 31.01.2023
[4] Le choix des zones de Bruxelles et du Hainaut-Sud, correspond à une volonté d’équilibre entre Région bruxelloise et Région wallonne, mais aussi entre centres urbains et zones rurales. L’objectif du dispositif expérimental étant par ailleurs de collecter des données, tout en visant à toucher environ un tiers de la population scolaire de ce niveau d’enseignement.
[5] A.G.C.F. 16.5.2024 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné du 16 mai 2023 relative au règlement de travail cadre pour le personnel directeur, enseignant et assimilé de l'enseignement officiel subventionné (spécialisé), M.B., 17.7.2024.

Focus sur la commune
Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.
Téléchargez cette fiche en PDF Découvrez l'ouvrage complet